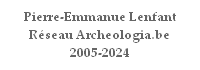|
|
|
|

|
|
"Origine, identité
et archéologie. A propos des rapports entre science et
politique à partir du cas de
l’archéologie dite nazie"
Laurent
Dartigues
CNRS, Triangle, ENS Lyon
Archeologia.be, 5 octobre 2017
Que devrait nous apporter l’archéologie
à la question des origines et de
l’identité des peuples ? Répondons tout
de suite : rien ! Est-il en effet nécessaire
d’épiloguer à propos de quelque chose
qui ne devrait guère faire débat dans les
sciences sociales tant cela est évident ? Mais nous
n’en sommes je crois pas quitte pour autant, à
condition de déplacer la question ou plus exactement de la
diffracter pour tenter de saisir la manière dont
l’archéologie ou plutôt une certaine
archéologie se noue à l’idée
d’origine et s’autoriserait ainsi d’une
politique de l’identité. Et pour cela inviter
à un voyage qui n’aura rien de linéaire
et passera notamment par une coordonnée délicate
qui a pour nom : archéologie nazie. Méconnaissant
le champ archéologique, mon approche sera purement textuelle
et n’a d’autre ambition que d’essayer
d’aborder la question de la politisation de
l’archéologie en espérant, en liaison
avec cette position d’extériorité,
apporter un peu de décalage.
Laurent
Dartigues est spécialiste
d'histoire et épistémologie des sciences. Il travaille
actuellement sur les usages par Michel Foucault de la psychanalyse
à partir du Fonds Foucault.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Que
veut en effet dire « archéologie nazie » ?
S’agit-il d’un raccourci pour dire que c’est une
archéologie pratiquée au temps des nazis ? Ou bien sous
la botte des nazis ou à leurs ordres ? Ce n’est
évidemment pas la même chose. Mais dans un cas ou dans
l’autre, j’estimerais pour ma part indispensable
d’écrire : une archéologie à
l’époque nazie. Ou tout autre formule de ce type, certes
lourde, mais la béance tragique ouverte par le nazisme qui a
failli engloutir l’histoire elle-même oblige à mes
yeux de ne pas tolérer le raccourci.
Ou bien s’agit-il encore d’autre chose, de quelque chose de
bien plus glaçant : une archéologie nazie en ses
méthodes, ses manières de voir les faits
archéologiques, de les connaître et de proposer des liens
entre eux ? Une archéologie qui serait donc proprement nazie. Et
pour laquelle du coup se poserait la question de savoir si elle a
constitué une avancée inédite de la connaissance,
un peu comme on dit que la micro-histoire italienne, ou les subaltern
studies indiennes ont ouvert de nouveaux champs de connaissance.
Une recherche dans différents fonds de textes en ligne
(Bibliothèque nationale de France, l’archive ouverte
hal-shs) ou diverses bases bibliographiques (Historical Abstracts,
cat.inist, Periodical Index Online) avec en première approche,
en anglais et en français, les mots « archéologie
» et « nazi » ou « nazisme » ou «
Troisième Reich » donne des résultats
extrêmement minces1. Font exception des travaux en langue
allemande qui se multiplient depuis une date récente,
malgré des travaux plus anciens demeurés semble-t-il
assez confidentiels (voir infra).
En langue française, un seul ouvrage apparaît clairement :
L’archéologie nazie en Europe de l’Ouest, livre
édité en 2007 et sur lequel je reviendrai2. Ça ne
veut pas dire évidemment qu’il n’existe pas
d’autres textes qui abordent en langue française cette
question, tels les articles de 1972 de l’historien de la
Grèce antique Pierre Villard ou bien de
l’archéologue Alain Schnapp, l’un en 1981
(Archéologie, archéologues et nazisme) et l’autre
en 2003 (L’autodestruction de l’archéologie
allemande sous le régime nazi), ou l’ouvrage publié
en 2001 sous la direction d’Isabelle Bardiès, Jean-Pierre
Legendre et Bernadette Schnitzler, L’archéologie en Alsace
et en Moselle au temps de l’annexion (1940-1944).
L’archéologie nazie en Europe de l’Ouest est donc un
ouvrage récent. Qui signale en vérité que le
thème apparaît nettement dans l’agenda scientifique
que depuis peu. Certes, il est présent depuis les années
1970, mais de manière tout à fait marginale, avec
quelques travaux pionniers en ce qui concerne l’organisation
institutionnelle de l’archéologie sous le IIIe Reich. Il
émerge plus franchement depuis le milieu des années 1990
où pointe d’autres thématiques grâce à
l’ouverture d’archives inédites après la
chute du Mur de Berlin et à la suite des décès de
quelques protagonistes importants de cette histoire.
L’archéologie nazie en Europe de l’Ouest regroupe
les actes d’une table-ronde internationale « Blut und Boden
»3e Congrès de l’Association européenne des
archéologues (European Association of Archaeologists). Les
contributions sont en français, anglais ou allemand.
organisée à Lyon en 2004 dans le cadre du X
À ma grande surprise, je dus constater que cet ouvrage
d’archéologie était fort mal distribué dans
les bibliothèques spécialisées de France4. Et
notamment, et paradoxalement, à Lyon où le
dénicher ne fut pas aisé. Je ne découvris
qu’un seul exemplaire dans un petit centre de documentation
rattaché au Centre d’études et de recherches sur
l’Occident romain de l’Université de Lyon. Une
localisation assez étonnante qui suscite une interrogation :
pourquoi à Lyon une visibilité si réduite ?
Écrivant dès lors à Laurent Olivier, conservateur
en chef du Patrimoine en charge des collections celtiques et gauloises
au Musée d’archéologie nationale de
Saint-Germain-en-Laye et l’un des codirecteurs de l’ouvrage
avec Legendre et Schnitzler, afin de recueillir son avis sur la
(relative) invisibilité du livre, j’obtins la
réponse résumée ci-après :
Olivier
y voit le symptôme de l’extraordinaire refoulement de cette
histoire – pour reprendre ses mots – et estime que les
institutions académiques apparaissent peu désireuses
d’en entendre parler.
Il
fournit également quelque information sur les conditions
d’organisation de la session sur l’archéologie
nazie. Elle fut d’abord refusée par les organisateurs
français et la médiation de l’EEA fut
nécessaire pour l’inscrire dans le programme. La course
d’obstacles n’était pas terminée pour autant.
Il fut notifié que l’Université de Lyon II, qui
hébergeait le congrès ne disposait plus de salle
libre… mais a fini par louer un local. Toutefois, la session ne
fut pas signalée sur les panneaux affichant le programme du
colloque.
Olivier
précise ainsi que la session, qui regroupait une vingtaine de
spécialistes européens s’est déroulée
en l’absence de tout public.
Pressentant que les actes ne seraient pas publiées en France,
dans la mesure où il faudrait solliciter l’avis des
organisateurs lyonnais qui s’étaient montrés si peu
accueillants, ils furent ainsi publiés aux frais des directeurs
de l’ouvrage – ou des participants à la session, je
n’ai point fait préciser cet aspect des choses – par
un éditeur francophone contacté par leurs soins et
intéressé par l’histoire contemporaine,
domicilié en Suisse (InFolio). Selon Olivier, le livre n’a
jamais fait l’objet de la moindre recension dans une revue
d’archéologie française5 (fin 2012).
Quels sont les enseignements qu’on peut tirer de cette anecdote ?
De quelle épistémologie faut-il armer
l’historiographie pour traiter le thème des rapports entre
l’archéologie et le nazisme ? Quels problèmes cette
historiographie laisse-t-elle peu ou prou dans l’ombre ?
L’objet de ce texte consistera à apporter quelque
éclairage à ces questions.
Une historiographie à la peine ?
L’appellation « archéologie nazie »
aurait-elle un effet polémique de dévoilement au point
qu’il vaudrait mieux réduire au silence les voix qui
porteraient le thème dans l’espace public ? Il en fut
d’ailleurs question lors de la parution en août 2012
d’un livre de ce même Olivier, au titre assez
énigmatique : Nos ancêtres les Germains. Les
archéologues au service du nazisme. L’auteur associe la
réception académique mitigée au fait qu’il y
traite notamment le cas des épigones français de cette
archéologie dite « nazie », suit (et dénonce)
son héritage en termes de transmission de méthodes et de
problématiques mais aussi de continuation des carrières
après 1945 (Voir Annexe 1). Constatons toutefois que l’accueil
médiatique de Nos ancêtres les Germains est bien au
rendez-vous si j’en juge les deux émissions
diffusées sur France culture (« La grande table » du
18 septembre 2012 et « Le salon noir » dédié
à l’actualité archéologique du 19 septembre
20126), le blog de l’ethnopsychiatre Tobie Nathan (http://tobienathan.wordpress.com/),
ou encore l’invite à la lecture formulée par les
magazines l’Histoire de novembre 2012 (n° 381) ou La
Recherche d’octobre 2012 (n° 469). Une réception
médiatique à laquelle il faut ajouter l’accueil
plus contrasté mais globalement positif exprimé par les
professeurs d’histoire Didier Paineau pour le compte du «
Salon littéraire » (voir à http://salon-littéraire.com/) et Guillaume Lévêque sur un site dédié à l’histoire (voir à http://clio-cr.clionautes.org/).
Et du côté de la réception académique, qui
semblerait en effet plus modeste, notons que par exemple le
compte-rendu rédigé en 2013 par l’historienne de
l’archéologie Catherine Valenti dans la revue Anabases
spécialisée dans les usages de l’Antiquité,
est tout à fait favorable à cette étude sur
l’« archéologie nazie » (voir à http://anabases.revues.org/4291).
À l’âge médiatique cependant, il convient de
garder à l’esprit que toute démystification est
souvent ipso facto parée des vertus de la preuve, d’autant
plus convaincante qu’elle serait dissimulée
jusque-là, ou mieux, tenue au secret par des
intérêts bien compris. Le 13 mars 2013, le journaliste
producteur du « Salon noir » sur France culture
présentait Olivier comme un “ troublion [sic]
forcément dérangeant pour sa hiérarchie ”.
Peut-être… mais l’univers académique ne
méconnaît pas la problématique – même
si elle reste confinée à de petits cercles – et il
convient quand même de rappeler que les quelques travaux
pionniers menés dans les années 1970 par des historiens
allemands ont commencé à déblayer une partie du
terrain. Ainsi que le rappelle Schnapp, on sait qu’“ en
1939 la majorité des préhistoriens et une bonne partie
des archéologues allemands avaient-ils rejoint, grâce aux
offices conjugués de Himmler et de Rosenberg, les rangs
d’un national-socialisme actif ” (Schnapp, 1981, p. 297).
Dans les années 19707 et 1980, il y a un accord assez
général pour dire que, grâce à
l’historien Reinhard Bollmus – auteur en 1970 de Das Amt
Rosenberg und seine Gegner : Studien zum Machtkampf im
Nationalsozialistichen Herrschaftssystem8 –, Mechthilde Unverzagt
– Wilhelm Unverzagt und die Pläne zur Gründung eines
Instituts für die Vorgeschichte Ostdeutschlands9 (1985) – ou
le préhistorien Ulrich Veit10, les noms des universitaires
allemands ayant inscrit leurs travaux dans les coordonnées de
l’idéologie raciale nazie mais aussi l’histoire
institutionnelle de l’archéologie allemande entre 1933 et
1945, sont relativement bien connus. Peut-être
l’archéologie était-elle jusque dans les
années 1990 le seule discipline à ne pas avoir fait une
étude critique de son rôle sous le régime nazi
(Arnold 1990), mais depuis notamment le début des années
2000, il semblerait que d’excellents ouvrages essentiellement de
langue allemande œuvrent à faire connaître en
profondeur les rapports qui se sont noués de 1933 et 1945 entre
l’archéologie – notamment la pré et
protohistoire –, la politique nazie et ses thèses raciales
(Arnold 2006). Le terme de « trublion » aurait en fait
quelque légitimité si on le restreignait au champ
académique français qui consacre peu de forces à
cette problématique des rapports noués entre le
régime nazi et les sciences en général,
l’archéologie en particulier. Avant les années
2000, on ne compte qu’une petite poignée de textes, dont
certains en outre ne s’exposent que dans des lieux en marge de
l’espace scientifique11.
Toutefois, il semble que demeure du trouble avec ce sujet “
provoquant ”, comme il fut dit par ce journaliste producteur du
« Salon noir » évoqué plus haut. Il reste en
effet un décalage en ce qui concerne le rôle de
l’archéologie dans la culture nazie par rapport à
d’autres sciences qui depuis la Seconde Guerre mondiale viennent
successivement se présenter comme celles qui ont le plus
collaboré avec le régime nazi. Aujourd’hui
l’archéologie, mais « hier », Karl Jaspers
pointait la responsabilité particulière des recherches
philosophiques et politiques et surtout de leur enseignement, dans la
propagande nazie (Jaspers 1946 : 16-18). En 1947, le géographe
Carl Theodor Troll12 (1899-1975), publiait dans le premier
numéro de la revue Erdkunde qu’il venait de fonder un
article intitulé : Die geographische Wissenschaft in Deutschland
in den Jahren 1933 bis 1945. Eine Kritik und Rechtfertigung (La science
géographique en Allemagne de 1933 à 1945. Une critique et
justification). Le travail pionner du médecin et anthropologue
Karl Saller (1902-1969) concernant la biologie raciale est
publié en 196113. À condition de stipuler que
jusqu’à la fin des années 1980, la science en
général est “ la grande oubliée ” de
l’histoire du nazisme à l’exception de la
médecine (Olff-Nathan, 1993, p. 8), l’archéologie
semble néanmoins une tard-venue dans cette liste. La recherche
considérée comme majeure du généticien
Benno Müller-Hill parue en Allemagne en 1984
s’intéresse à la psychiatrie et à
l’anthropologie biologique ; le livre dirigé par Josiane
Olff-Nathan issu d’un séminaire tenu à
l’Université Louis Pasteur de Strasbourg en 1989-1990 sur
la responsabilité de la science sous le nazisme, traite de
l’anthropologie raciale, de l’histoire, de la
géographie, de la biologie, des technologies de reproduction.
Dans les deux cas, point d’archéologie, et il semble
unanimement reconnu que “ ils [les anthropologues raciaux] furent
avec les médecins, les généticiens humains et les
psychiatres, les auxiliaires les plus zélés de la
politique raciale nazie ” (Massin 1993, p. 208) ou que, par
exemple la conquête de l’Est de l’Europe se soit
préparée avec des géographes, des
démographes, des généticiens, et même des
botanistes, mais pas d’archéologues14. Bettina Arnold
qu’on considère comme une des pionnières quant
à l’étude de la responsabilité de
l’archéologie15 et qui estimait (en 1989-90) qu’un
seul préhistorien allemand avait osé se lancer dans cette
analyse16, émet l’hypothèse que
l’archéologie en général et la
préhistoire en particulier ont été
protégées en la matière par ce qu’elle
appelle une « cinderella story » (Arnold 2006, p. 12).
Autrement dit, une légende dorée qui présente
l’archéologie comme une discipline de deuxième
zone, éloignée des préoccupations politiques du
moment, en outre peu dotée en moyens humains et matériels
au regard d’autres sciences plus prestigieuses.
Le trouble relatif à l’archéologie ne devrait-il
toutefois résider que seulement là où cela est
pointé par le livre d’Olivier, à savoir le
dévoilement tardif d’un refoulement durable du rôle
politique de la science et de l’héritage de cette
archéologie dans le monde de l’après-Guerre17 ? Il
devrait jouer aussi à mon avis à un autre niveau. Je
crois en effet que la désignation de cette archéologie
comme « nazie », par certains archéologues ou
historiens, est également fort embarrassante.
Une critique épistémologique
Le vocable « science nazie » – «
archéologie » dans le cas présent, mais il existe
des articles qui parlent de sociologie nazie, de linguistique nazie,
etc. – est à mes yeux un abus de langage. Et je
préfère très nettement le sous-titre
proposé par Olivier à Nos ancêtres les Germains,
Les archéologues au service du nazisme ; ou le titre sur une
thématique proche de Johann Chapoutot : Le national-socialisme
et l’Antiquité18(2008) : des savants et non la science,
une dialectique et non l’identité.
Autrement dit, je ne suis pas convaincu par les arguments
d’Olivier qui assoient l’idée que cette
archéologie est quelque chose de plus ou d’autre
qu’une science au service de la légitimation de la
politique nazie justifiant l’appellation d’«
archéologie nazie ». J’en questionne
brièvement certains d’entre eux.
La profession fut la plus nazifiée derrière les juristes. Les études montrent que 86 % des archéologues étaient membres du parti nazi.
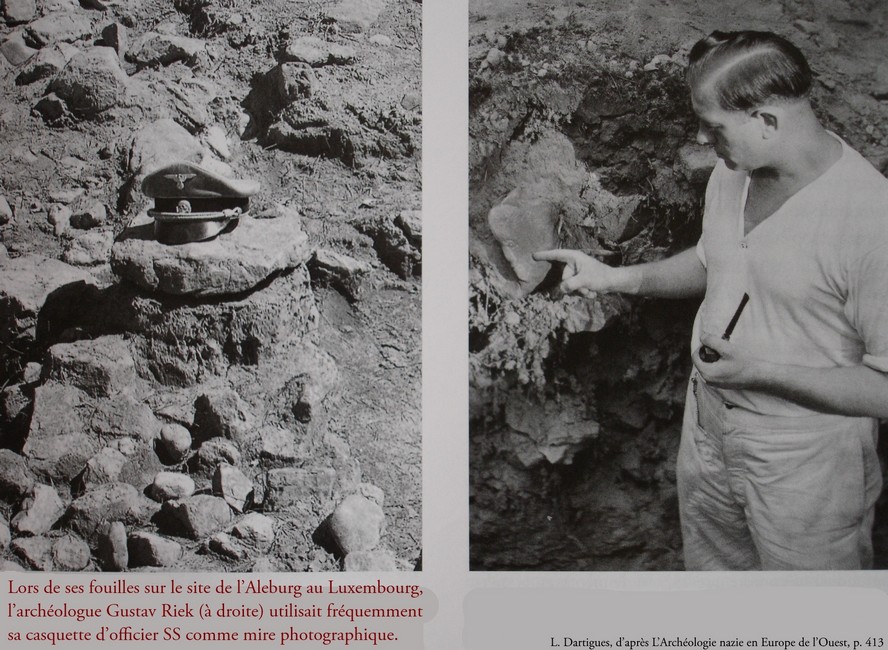
Chiffre éloquent19, mais un archéologue nazi fait-il
forcément une archéologie nazie20 ? Sans m’attarder
sur la questions des affiliations partisanes – la variable ne
suffit pas en elle-même à expliquer un contenu,
d’autant qu’après 1933 de formidables
opportunités sont offertes par le pouvoir nazi en termes de
crédits, de création de chaires et de services, de
carrières21 – il faudrait pour cela faire valoir, dans les
méthodes et les analyses, le lien entre l’idéologie
nazie dite völkisch22 et la production scientifique. J’y
reviendrai.
Une institutionnalisation nazie de l’archéologie fut orchestrée.
Dès 1934, Rosenberg fonde une structure de recherche
rattachée au NSDAP, La Ligue (ou L’Alliance) du Reich pour
la préhistoire allemande du NSDAP, connue sous le nom de
L’Office Rosenberg (Amt Rosenberg). Et en 1935 Himmler fait de
même au sein de la SS avec l’institution appelée
L’Héritage des ancêtres (Ahnenerbe), une
nébuleuse comprenant 51 sections de recherche dont 6
dédiées à l’archéologie23. Dans sa
volonté de légitimer historiquement la suprématie
des Germains en Europe, la préhistoire ou la proto-histoire,
parents pauvres de l’archéologie allemande, allaient se
voir choyer par le pouvoir nazi.
Il ne faut pas oublier toutefois qu’une archéologie civile
demeura, en dehors des organismes nazis, tel l’Institut
archéologique allemand (DAI), centre de
l’archéologie classique créé en 1829 ainsi
que des services archéologiques attachés aux
administrations régionales. Il est vrai, certaines de ses
structures ont joué “ un rôle actif dans
l’entreprise de légitimation de l’annexion au Reich
de certaines régions de l’Ouest de l’Europe ”
(L’Archéologie nazie en Europe de l’Ouest, p. 36).
En ce qui concerne la prestigieuse DAI, sa direction fut
centralisée, les Juifs Allemands exclus, les bourses de voyage
octroyées en fonction de l’ascendance aryenne et cet
institut d’archéologie gréco-romaine dut
développer des recherches sur les Germains (Junker 1998). Mais
il semblerait que la DAI n’ait pas vu ses productions
instrumentalisées par le pouvoir nazi. Probablement parce que ni
sa stricte érudition, ni les temps et les espaces auxquels elle
s’intéressait – malgré
l’intérêt d’Hitler lui-même pour
l’Antiquité gréco-romaine –ne pouvaient
entrer en affinité étroite avec l’idéologie
völkisch au contraire de la pré- et proto-histoire.
L’archéologie
fut irriguée par une idéologie racialiste en
général et le mythe aryen en particulier. Elle
cherchait donc à démontrer que le territoire
européen était à l’origine un sol
occupé par des Indo-Germains et que l’Allemagne fut la
source des grandes civilisations : l’archéologie serait
nazie parce qu’elle se réduirait à la validation a
posteriori de postulats raciaux, repeignant le passé aux
couleurs de la race aryenne, et ce faisant légitimant la
politique de peuplement et d’épuration raciale
menée dans les pays de l’Est de l’Europe ou
l’occupation de l’Europe de l’Ouest.
C’est l’argument le plus fort qui revient aussi à
dire qu’on se trouve au-delà d’un
détournement par la propagande des données
archéologiques, mais que celles-ci ont été
inventées pour donner consistance au dogme nordique.
L’hypothèse souffre pourtant de quelque restriction. En
premier lieu, on ne voit pas comment l’archéologie
eût pu se faire sans cette référence si «
massive ». On pourrait donc avancer que
l’archéologie dite nazie présente vraisemblablement
une différence de degré avec le régime de toute
science qui n’est pas un régime « hors-sol »,
mais n’affiche pas une différence de nature justifiant
l’épithète de « nazi ».
De ce premier voyage, il me semble pouvoir dégager deux ou trois
choses. Tout d’abord que l’affaire demande prudence et
prise de distance à l’encontre de toute conclusion un peu
définitive. "Le nazisme a-t-il été le moteur
idéologique de ces sciences [anthropologie physique, biologie et
droit] ou ces sciences ont-elle réalisé leurs propres
visions sous le nazisme ? Il n’y a pas de réponse directe
à cette question”24 : Prenons donc acte que la route est
sinueuse, la question à diffracter et non à cadrer.
Peut-être aussi faut-il prendre acte qu’il n’y a rien
de vraiment neuf sous le soleil. Cette archéologie dans son
rapport au politique est probablement singulière, mais je ne
vois pas en elle une spécificité à ce sujet.
Chapoutot le rappelle, le dévouement de
l’archéologie – comme l’histoire ou
l’anthropologie – à la cause du IIIedans la droite
ligne de la tâche remplie par ces disciplines dans le processus
de construction des identités nationales au XIXe siècle
” (p. 54). Et que du coup, il importe de sortir de
l’alternative science pure/science impure et de
s’intéresser à comprendre les raisons qui ont
poussé des savants à inscrire la vulgate nazie dans leurs
pratiques scientifiques. Dit autrement, il s’agit de
s’intéresser aux usages de l’archéologie
à des fins qui ne relèvent pas que de la connaissance ;
de refuser l’impasse d’un questionnement sur la science
porteuse en elle-même d’un « mal » qui
conduirait à voir dans l’archéologie une science
idéologique par essence, inévitablement vouée
à devoir servir des causes politiques funestes. Reich est
“
L’idée d’usage ne résout toutefois pas cette
question : Pourquoi précisément cette discipline de
l’érudition censée ne pas avoir de rapport avec le
pouvoir politique – et d’ailleurs longue serait
l’occultation25 de l’exploitation idéologique des
découvertes archéologiques par le parti nazi ?
Susciterait-elle en sa langue propre une inclination, une tendance, une
attraction particulière pour des usages politiques ?
L’abord par les usages constitue un nécessaire
déplacement – je le redis – mais laisse cette
interrogation intacte.
Je propose d’aborder ce problème avec un concept
proposé par le philosophe Georges Canguilhem : la connotation.
Canguilhem nous suggère ainsi que des affinités
électives se nouent entre certains types de savoir et leurs
usages politiques ou sociaux du fait que ces savoirs particuliers ont
un pouvoir évocateur saillant. Reformulée pour mon
propos, l’hypothèse s’écrirait ainsi : les
objets désignés par l’archéologie ne
sont-ils pas hautement investissables par un imaginaire hanté
par l’inexorable action du temps sur la matière
d’une part, fascinée par le crépuscule des
civilisations antiques d’autre part ?
Pour le dire autrement : Si l’archéologie est bien
sûr une discipline scientifique attachée à
décrire patiemment les traces matérielles du passé
pour tenter de reconstituer l’état de
sociétés anciennes, ne se pense t-elle pas aussi chez
certains comme une science interprétative qui exhume les
sociétés disparues qui peuplaient le monde avant «
nous » ? Et à ce titre n’est-elle pas à
comprendre également comme un imaginaire d’autant plus
travaillé par la question des origines que la dimension
éminemment lacunaire de sa documentation favorise
l’investissement imaginaire des objets qu’elle
désigne ?
Dans un petit livre d’intervention distanciée relatif au
débat français sur l’identité nationale,
Marcel Detienne rapproche identité nationale et origine26. Suite
aux guerres du Ve siècle avant J.C. menées par
Athènes contre les Mèdes et les Perses, la cité
grecque se mit à souffrir d’“ une poussée
d’hypertrophie du moi ” (p. 26). Athènes
établit sa prééminence sur les autres cités
grecques en concevant l’idée d’un peuple autochtone,
issu donc de son propre sol, à travers une nouvelle institution
créée à cette époque. Les combattants ne
sont plus enterrés sur le champ de bataille, mais ramenés
dans la cité pour y recevoir des funérailles collectives
et publiques. La cérémonie consiste à
célébrer leur mémoire et comprend un éloge
sous la forme d’une oraison funèbre qui débute
ainsi : « Nous sommes les autochtones... ». C’est
donc un discours politique qui advient dans et fait advenir la
démocratie athénienne et que l’historienne Nicole
Loraux appelle d’ailleurs l’« idéologie de la
cité »27. Le genre littéraire de ces oraisons
funèbres est baptisé du nom d’archéologie,
soit le discours sur les origines (ou les commencements).
L’archéologie se présentait comme une
idéologie de l’origine qui lui conjugue les mots de mort
et de mémoire.
Indéniablement, l’archéologie en tant que domaine
de savoir implique toujours l’idée d’origine.
Olivier précise qu’elle a transformé la notion
mythique d’origine en concept scientifique.
Elle n’est pas la seule discipline en cause. Marc Bloch consacre
un chapitre à ce qu’il appelle l’idole de la tribu
des historiens : la hantise des origines. Il relève cette
tendance de l’histoire à transformer l’origine en
cause, la simple filiation en une explication, postulant en quelque
sorte l’idée (métaphysique pour Bloch) d’un
germe « déjà-là » à
l’origine qui ne ferait que se déployer dans le temps28.
« Origine » est donc un maître-mot que
l’archéologie ou l’histoire ont
réifié, transformant quelque chose de mouvant, de
dynamique, de partiellement insaisissable en une
référence objective, statique, située. Ce faisant,
elles en ont facilité les usages politiques, dans le sens
où l’antériorité a pu devenir une question
de « légitimité sur », sur le mode : «
J’étais là avant vous ! ».
L’archéologie pratiquée par les archéologues
de l’Amt Rosenberg ou de l’Ahnenerbe cherchait en effet
à montrer que le territoire européen était
occupé à l’origine par des Indo-Germains. Chapoutot
nous éclaire sur la manière dont
l’archéologie allemande fut antérieurement au
Troisième Reich travaillée, traversée par cette
question des origines. Il note que la germanité était
perçue (par les élites intellectuelles allemandes) comme
frustre. Un effort fut entrepris pour la parer d’un prestige
culturel en la dotant de la généalogie noble entre toutes
: la référence à l’antiquité
gréco-romaine. C’est-à-dire en produisant le
“ discours des origines, la biographie d’un Urvolk ennobli
par le prestige d’Auguste et de Périclès”
(p. 4). Urvolk est un mot difficile à traduire : peuple originel
? Ce serait édulcorer le goût passionné du
romantisme allemand pour les origines, sa glorification du primitif, sa
sanctification de l’originel comme critère de valeur de la
civilisation : "Quel mot de chez nous réussira jamais
à rendre la force de ce fameux préfixe germanique Ur ?
Tout inclinait donc ces générations à attribuer,
dans les choses humaines, une importance extrême aux faits du
début" (Bloch, Apologie pour l’histoire ou
Métier d’historien, p. 54). Encore faut-il saisir que le
but de la recherche archéologique allemande n’était
pas d’établir une filiation, mais une paternité.
Autrement dit, un discours des origines d’avant l’origine
faisant exister une humanité des origines indo-germaines.
C’est aussi dire que les Allemands sont partout chez eux en tant
que peuple « premier » : l’antériorité
devient en quelque sorte une règle de droit (voir Annexe 2). Ce qui explique les
fouilles archéologiques sous direction nazie menées en
Europe de l’Ouest entre 1939 et 1945, par exemple à Carnac
afin de prouver que les Celtes sont en fait des anciens Germains.
Cette fonction de l’archéologie vis-à-vis des
origines, cette politisation de l’archéologie, nous en
avons des exemples actuels, en particulier avec
l’archéologie dite religieuse, de Jérusalem29
à Ayodhya en Inde. La question identitaire qui aujourd’hui
submerge la question sociale sur l’agenda politique
n’offre-t-elle pas un riche terreau pour de tels usages de
l’archéologie ?
Annexe 1
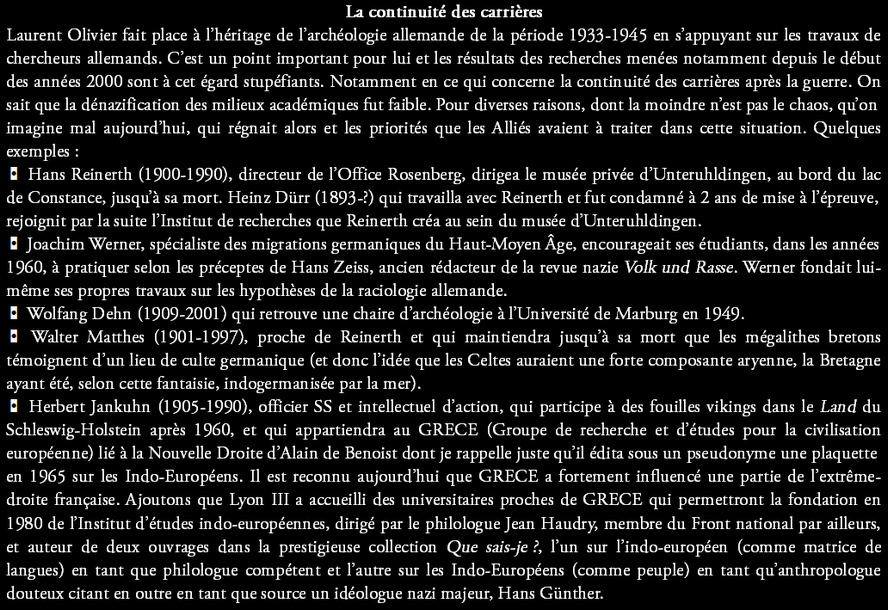
Annexe 2
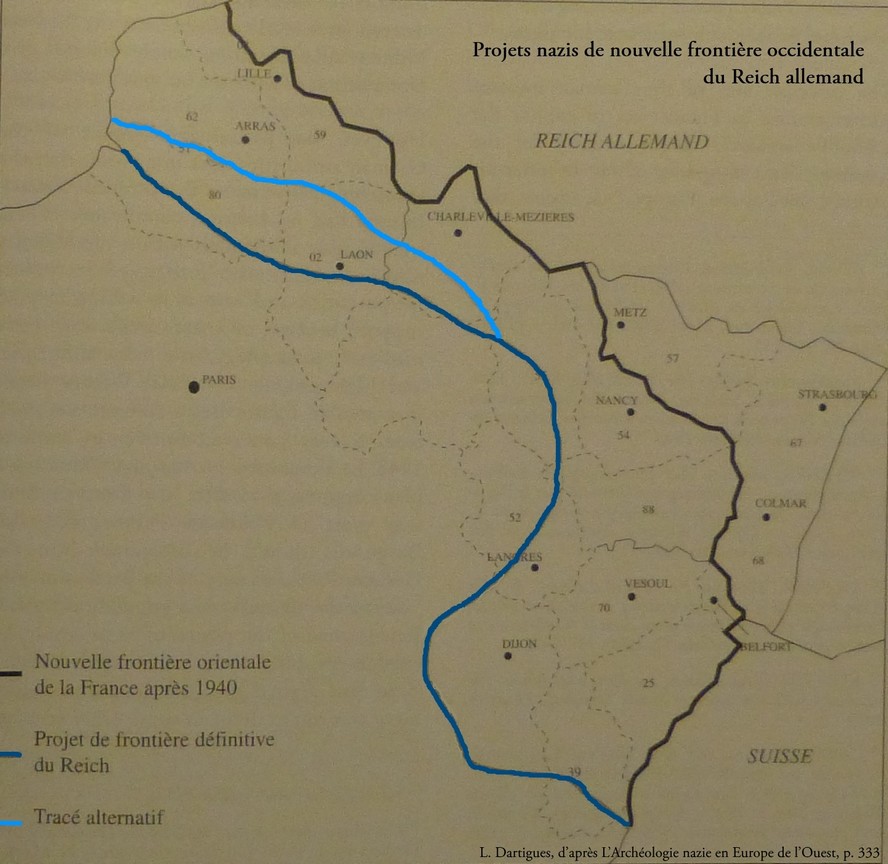
* * * *
Notes
1 Quant à la base Web of Science, elle ne fournit qu’une
occurrence, un article d’Uta Halle paru en 2005 dans la revue
Archäologisches Nachrichtenblatt. Ce qui signale essentiellement
les failles de cette base qui survalorise les publications et les
revues de langue anglaise.
2 Il s’agit du titre de la couverture, le livre porte
également celui-ci : L’Archéologie
nationale-socialiste dans les pays occupés à
l’Ouest du Reich.
3 « Sang et Sol » et donc la manière dont
l’idéologie nazie définissait
l’identité allemande.
4 Sur les 27 localisations pour toute la France, dont 11 exemplaires
dans différentes institutions universitaires parisiennes et 3
exemplaires dans la ville de Strasbourg où travaille un des
codirecteurs de l’ouvrage, les bibliothèques
universitaires de lettres se taillent la part du lion. Pas plus de 3 ou
4 bibliothèques spécialisées possèdent cet
ouvrage (en 2013).
5 Ce à quoi il se trompe. L’Archéologie nazie en
Europe de l’Ouest fut recensé par Philippe Foro dans la
revue Anabases, 2008, 8, 319-320 et Pedro Paulo Funari dans Public
Archaeology, 2008, 7, 2, 135-138.
6 Notons néanmoins que « Le salon noir » avait fait
place à L’archéologie nazie en Europe de
l’Ouest le 25 avril 2004.
7 Villard est le seul ou un des rares à citer, à propos
des études antiques, l’historien Joseph Wulf,
rescapé d’Ausschwitz, qui collabora avec Léon
Poliakov dans les années 1950 et auteur en 1963 de Die Bildenden
Künste im Dritten Reich (Les Beaux-Arts sous le Troisième
Reich, toutes les traductions de l’allemand seront de mon fait).
Wulf soutient la thèse que, même si cela est peu apparent
et fort surprenant, l’Antiquité est un
élément fort du système de pensée
hitlérien. Voir Villard 1972.
8 L’Office Rosenberg et ses opposants : études sur une
lutte de pouvoir au sein du système hégémonique
nazi.
9 Wilhelm Unverzagt et les projets de fondation de l’Institut
pour la préhistoire de l’Allemagne de l’Ouest.
10 Et son essai paru dans Saeculum en 1984 sur le rôle du
linguiste Kossinna dans la constitution d’une archéologie
compatible avec l’idéologie raciale nazie.
11 Sans prétendre à
l’exhaustivité, outre l’article de Schnapp
déjà cité, signalons l’ouvrage paru en 1993,
et dont je tire les informations qui suivent, d’Olff-Nathan (voir
ci-après), le livre dirigé par François
Bédarida issu d’une journée d’étude
organisée par l’Institut d’histoire du temps
présent en décembre 1987 au sujet de la politique nazie
d’extermination. La deuxième partie de l’ouvrage
(qui en compte six) – « L’idéologie et la
science au service du génocide » – comporte un
chapitre dédié au rôle de l’anthropologie, de
la biologie et du droit dans la biopolitique nazie. L’auteur,
Michael Pollack, en publiera une version simplifiée (avec le
titre La « science nazie ») dans le magazine
L’Histoire (janvier 1989, n° 118) et c’est
également un autre magazine, La Recherche, qui consacrera en
1990 son dossier à cette problématique du
côté de la médecine. Voir La Recherche, déc.
1990, n° 227, le dossier « Le nazisme et la science »
et ses deux articles de Benoît Massin, De
l’eugénisme à l’« opération
euthanasie » 1890-1945 et de Pierre Thuillier, Les
expérimentations nazies sur l’hypothermie
(l’introduction stipule qu’on ne peut se débarrasser
du problème en proclamant que les Nazis pratiquaient de la
mauvaise science, ils s’appuyaient au contraire sur la vraie
science et des scientifiques réputés, p. 1562). Il me
semble qu’on ne peut passer sous silence les travaux, trop
rarement cités dans ce cadre, de Poliakov sur
l’archéologie des savoirs produisant le mythe aryen.
12 Cité par Rössler 1993.
13 Cité par Massin, 1993. Saller avait refusé de
souscrire aux thèses nazies issues de la biologie raciale et en
fut d’ailleurs sanctionné en étant juridiquement
réduit au silence. L’ouvrage dont il s’agit
s’intitule : Die Rassenlehre des Nationalsozialismus in
Wissenschaft und Propaganda (L’idéologie raciale nazie
dans la science et la propagande).
14 Olff-Nathan, op. cit., p. 19.
15 Avec Bollmus et Unverzagt selon Klaus Junker (1998). Il s’agit
d’un article paru en 1990 issu d’une contribution faite en
1989 à un congrès d’archéologie à
Baltimore. Arnold, diplômé de Harvard, est une
spécialiste de l’Âge de fer.
16 À savoir Ulrich Veit.
17 D’autant que cette problématique n’est en rien
inédite, voir par exemple Heidrun Kaupen-Hass (1993) à
propos de la postérité des techniques de contrôle
de la reproduction mises au point sous le Troisième Reich.
18 Identique à celui de Volker Losemann, Nationalsozialismus und Antike (1977).
19 Selon Olff-Nathan, la mise au pas des universitaires en
général ne rencontra pas beaucoup d’obstacles,
jouant de leur “ conservatisme légaliste ”
(Olff-Nathan, La science sous le Troisième Reich, 1993, p. 20).
Cela n’étonnera que ceux qui s’imaginent que la
culture est en soi une protection contre le totalitarisme.
20 Question que pose pour la philosophie Carsten Klingemann. Il
rappelle que Rosenberg avait cherché à créer une
science nazie, organisant en mars 1939 un colloque pour persuader un
petit groupe de philosophes de mieux se soumettre aux directives du
Parti. Voir Les sociologues nazis et Max Weber, 1933-1945,
Genèses, 1995, 21, pp. 53-74.
21 Symétriquement, il convient de ne pas réduire cet
engagement massif à du pur pragmatisme, ne serait-ce que parce
que 25 % des archéologues allemands ont adhéré au
parti nazi (NSDAP) avant 1933. Les motivations sont de toute
façon probablement mêlées, l’adhésion
sincère à une idéologie d’aryanisation du
passé n’est pas exclusive d’une dose
d’opportunisme et d’un calcul d’intérêt,
ni l’encartement au NSDAP empêcher d’être
sourcilleux quant à la rigueur scientifique de sa pratique.
22 La pensée völkisch ou pangermaniste prône la
supériorité de la race nordique et se fascine pour une
préhistoire germanique, pré-chrétienne,
perçue comme un âge d’or.
23 Voir Legendre, Olivier, Schnitzler, Introduction, L’archéologie nazie en Europe de l’Ouest, 2007.
24 Pollak, art. cit., 1989, p. 88.
25 Ainsi que le note Christian Ingrao, Croire et détruire. Les intellectuels dans la machine de guerre SS, 2010.
26 L’identité nationale, une énigme, Gallimard (Folio histoire), 2010.
27 Loraux, Mourir devant Troie, tomber pour Athènes : de la
gloire du héros à l’idée de cité, p.
39, dans : La mort, les morts dans les sociétés
anciennes, G. Gnoli & J.-P. Vernant (ss. dir.), Cambridge
University Press/MSH, 1982.
28 En écrivant que “ Savoir, même dans l’ordre
historique, ne signifie pas « retrouver », et surtout pas
« nous retrouver » ” (p. 1015), Michel Foucault ne
dit pas autre chose. Il bannit par là les pratiques historiennes
antiquaires qui se feraient “ les fripiers des identités
vacantes ” (p. 1021) et justifieraient le droit que certains
s’arrogent du simple fait d’être nés
là. Voir Foucault, « Nietzsche, la
généalogie, l’histoire », Dits et
Écrits, I.
29. Voir par exemple Vincent Lemire,
Jérusalem 1900. La Ville sainte à l’âge des
possibles, Armand Colin, 2013. L’auteur nous fait notamment
côtoyer des archéologues occidentaux occupés
à creuser le sous-sol avec acharnement pour faire ressurgir les
lieux saints de la « Jérusalem biblique » comme si
la bible avait valeur de cadastre.
|
|
|
|
|
|
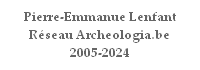
|
|